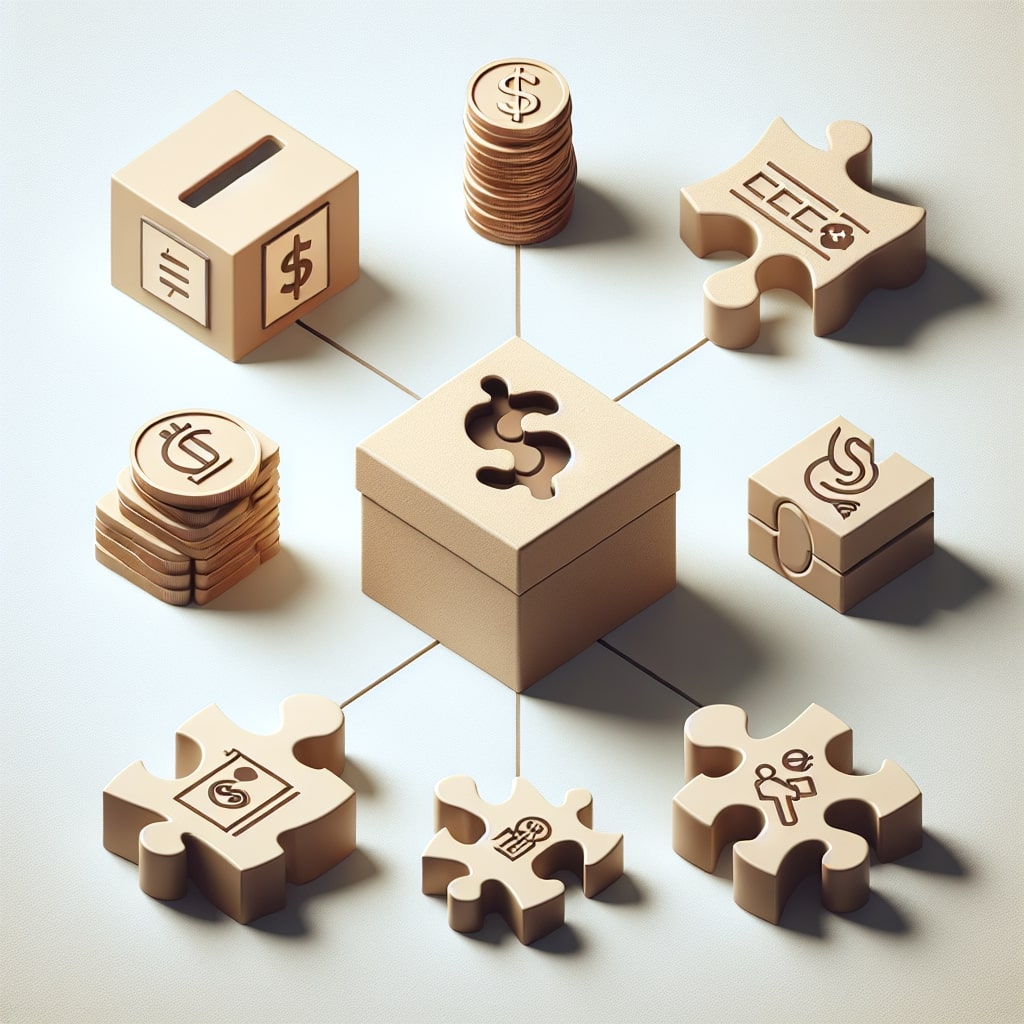Le revenu universel, aussi appelé revenu de base, est une idée économique et sociale qui revient régulièrement dans les débats politiques et économiques. Son objectif est de garantir un revenu minimum à chaque citoyen, indépendamment de sa situation professionnelle ou financière. Cependant, la question centrale reste : comment financer un tel dispositif sans déséquilibrer les finances publiques ni freiner la croissance économique ?
Le coût du revenu universel : un défi majeur
Avant d’évoquer les solutions de financement, il est essentiel d’évaluer le coût global de la mise en place d’un revenu universel. En France, le Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB) estime qu’un revenu universel de 450 € par adulte et 200 € par enfant coûterait environ 13,7 % du PIB, soit près de 300 milliards d’euros par an.
Toutefois, plusieurs éléments doivent être pris en compte pour affiner cette estimation : le remplacement des aides sociales existantes, un revenu universel venant remplacer des allocations comme le RSA, les allocations familiales et certaines aides sociales, ce qui permettrait de réduire le coût net du dispositif ; la réduction des coûts administratifs, en fusionnant les différentes prestations sociales en une seule, les dépenses de gestion diminueraient ; l’impact sur l’activité économique, certains économistes estiment que le revenu universel pourrait stimuler la consommation et l’entrepreneuriat, augmentant ainsi les recettes fiscales.
Les différentes sources de financement
Le financement par l’impôt
La solution la plus souvent évoquée pour financer un revenu universel repose sur une hausse des impôts, notamment via :
- Une réforme de l’impôt sur le revenu : certains économistes, comme Piketty et Saez, suggèrent une refonte de l’impôt avec des tranches progressives allant de 31,6 % à 45 %.
- Une taxation des hauts revenus et des grandes fortunes : une augmentation de l’impôt sur la fortune ou l’instauration d’un impôt sur les successions plus élevé.
- Une TVA augmentée : certains pays comme la Finlande ont étudié la possibilité de financer un revenu universel en augmentant la TVA, ce qui permettrait de taxer la consommation plutôt que le travail.
- Une taxe sur les transactions financières (Taxe Tobin) : cette taxe sur les mouvements de capitaux pourrait générer des recettes importantes tout en limitant la spéculation.
Limites : une hausse de la fiscalité peut entraîner une fuite des capitaux et une baisse de la compétitivité. Il est donc nécessaire d’équilibrer cette approche avec d’autres sources de financement.
L’exploitation des ressources naturelles et des actifs publics
Certains pays financent déjà une forme de revenu universel via les ressources naturelles :
- Le modèle de l’Alaska : depuis 1982, l’État de l’Alaska redistribue à ses citoyens une partie des revenus générés par l’exploitation pétrolière. Ce fonds souverain finance un dividende annuel versé aux habitants.
- Une taxe écologique sur les entreprises exploitant des ressources naturelles : les entreprises utilisant des matières premières ou émettant des polluants pourraient être mises à contribution.
La création monétaire et la dette publique
Certains défenseurs du revenu universel suggèrent de financer ce dispositif par la dette ou la création monétaire. Cette approche, parfois qualifiée de « monnaie hélicoptère », consisterait à créer de la monnaie et la distribuer directement aux citoyens.
Limites : cette méthode comporte un risque inflationniste important. Une création excessive de monnaie pourrait diminuer la valeur de la monnaie et provoquer une hausse des prix, réduisant ainsi le pouvoir d’achat.
Un investissement public productif
Une alternative plus durable consiste à investir dans des actifs productifs :
- L’État pourrait développer un fonds souverain qui génère des revenus via des placements dans l’immobilier, les infrastructures et les entreprises stratégiques.
- Ces investissements permettraient de créer une source de revenus stable et durable pour financer progressivement le revenu universel.
Les défis liés à la mise en place du revenu universel
Plusieurs défis doivent être anticipés : la concurrence fiscale entre les États, une forte imposition pour financer le revenu universel pourrait inciter les grandes fortunes et les entreprises à délocaliser leurs activités vers des pays à fiscalité plus avantageuse ; les effets sur l’emploi, certains redoutent que le revenu universel décourage la recherche d’emploi, tandis que d’autres y voient un levier pour encourager l’entrepreneuriat et la reconversion professionnelle ; la stabilité du financement, dans un contexte de mondialisation, les recettes fiscales peuvent varier fortement en fonction des crises économiques et des évolutions technologiques.
Un compromis possible : le modèle LIBER
Pour répondre aux critiques et assurer un financement viable, l’économiste Marc de Basquiat a proposé le modèle LIBER. Ce revenu universel serait financé via une LIBERTAXE de 23 %, appliquée à tous les revenus, remplaçant ainsi l’impôt sur le revenu et certaines cotisations sociales. Le montant du LIBER serait de 480 € par adulte et 200 € par enfant, permettant de lutter contre la pauvreté sans déséquilibrer les finances publiques. Cette approche cherche à simplifier le système socio-fiscal actuel, en supprimant de nombreuses niches fiscales et exonérations.
Le financement du revenu universel est finalement un défi complexe qui nécessite une approche combinée. Une fiscalité plus juste, une meilleure utilisation des ressources naturelles, des investissements stratégiques et une optimisation des dépenses publiques pourraient permettre d’assurer la viabilité de ce projet. Toutefois, pour éviter une fuite des capitaux, une hausse de la dette publique et une désincitation au travail, il est essentiel d’adopter une réforme équilibrée et pragmatique, s’appuyant sur une transition progressive et des expérimentations à l’échelle locale avant une généralisation nationale.